On le sait : l’agriculture est une activité fragile, car très dépendante des aléas climatiques. Et les aléas climatiques, au XXIe siècle, c’est parti pour se multiplier et poser de gros problèmes à l’humanité toute entière, puisque année après année les prévisions du GIEC se trouvent malheureusement confirmées.
Il va donc falloir que l’agriculture s’adapte à des conditions (rapidement) changeantes et à des périodes extrêmes sans doute plus nombreuses à tel ou tel endroit. On peut penser a priori que dans ce contexte on aura besoin du génie génétique et de toutes les techniques permettant de mettre au point rapidement et précisément les espèces à cultiver qui soient les plus adaptées à telles et telles conditions, mais bizarrement il y a un courant de gens qui veulent encore compliquer l’équation et qui se disent écolos et solidaires tout en s’opposant à ces solutions possibles.
Mais au-delà de cette question (décisive) du changement climatique, l’agriculture est soumise à des variations annuelles qui peuvent déjà à elles seules s’avérer redoutables pour les producteurs : un coup de gel trop tardif, ; un épisode de grêle qui tombe au mauvais moment ; trop de soleil ou pas assez de soleil à telle ou telle période de l’année pour telle ou telle plante, et c'est la qualité de la production voire la récolte elle-même en en prennent un coup.
Par exemple, cette année, le printemps a été plutôt très arrosé. De mon point de vue d’ardéchois de base, c’est une très bonne chose, parce que ça a bien rechargé les rivières et les aquifères avant d’affronter la sécheresse estivale. Oui mais, je ne suis pas le seul à avoir aimé ça, et il est une catégorie de quelque chose comme des micro-champignons qui affectionnent ces conditions-là et en profitent pour s’épanouir au maximum . On les appelle le mildiou :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mildiou
Du coup, en se développant, le mildiou peut ravager des cultures que les êtres humains avaient au départ plantées pour se nourrir eux-mêmes, plutôt que pour nourrir ce « parasite » ou cette « peste » (pour reprendre le terme qui a donné son nom aux pesticides, ces produits qui tuent les pestes afin que l'on se garde le maximum de bouffe pour nous). Peuvent ainsi être menacées les cultures de raisin, de tomates, de tabac (oui mais là on s’en fout : qu’elles crèvent, les plantations de tabac, et qu’elle dégagent de la place pour des cultures vivrières plutôt que pour ces cultures cancérigènes qui puent), de céréales, de canne à sucre, etc. etc. Mais l’épisode le plus célèbre de l’histoire en matière d attaque de mildiou concerne la pomme de terre, avec la grande famine européenne des années 1840, qui a été particulièrement dramatique en Irlande. Si quelques 10 000 personnes auraient succombé en France, du côté de l’Irlande, entre 1845 et 1852, alors que la patate était devenue la base de l’alimentation et que l’ensemble des récoltes furent anéanties par le parasite, c’est toute la société qui a été déstructurée par la catastrophe, avec autour d’un million de morts et deux millions de réfugiés, qui fuyaient les conséquences de la catastrophe et cherchaient à trouver asile ailleurs. Heureusement pour eux, les frontières, notamment aux Etats-Unis, étaient alors moins fermées que ne le sont celles de l’Union Européenne (ou des Etats-Unis) aujourd’hui….
https://fr.wikipedia.org/wiki/Famine_de_la_pomme_de_terre_en_Europe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grande_Famine_en_Irlande


Agrandissement : Illustration 2

Heureusement, depuis cette époque, la science et la technique ont permis de mieux protéger les cultures de ces possibles désastres. Les progrès techniques ont notamment permis de développer une catégorie de produits dits « phytosanitaires » (= qui « soignent » les plantes ») ou « pesticides » (= qui tuent les pestes, donc), de la même manière qu’on a développé des antibiotiques et autres médicaments pour ne pas partager nos organes avec certains micro-organismes qui peuvent nous parasiter (et éventuellement nous tuer).
Or, on le sait, les pesticides ont mauvaise presse et, alors que dans les pays développés notre alimentation n’a jamais été aussi variée et sûre, de plus en plus de gens sont persuadés de prendre des risques terribles en passant à table. Leurs croyances (erronées) sont alimentées par l’air réac du temps, mais aussi par tout un réseau d’agents intéressés (industrie du bio, ONGs vertes, grande distribution…) qui surfent sur les peurs alimentaires et en font leur business. Tout cela est démontré en détails avec plein d’exemples précis dans l’excellent livre de Gil Rivière-Wekstein Panique dans l’assiette, dont je recommande vivement la lecture très instructive
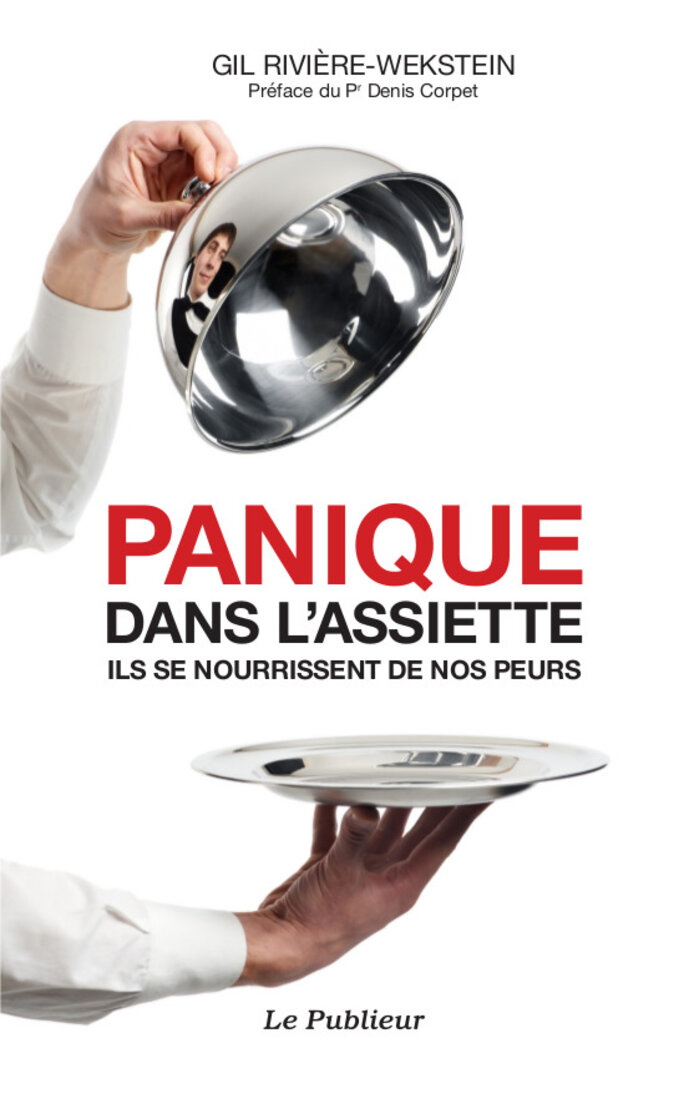
Agrandissement : Illustration 3
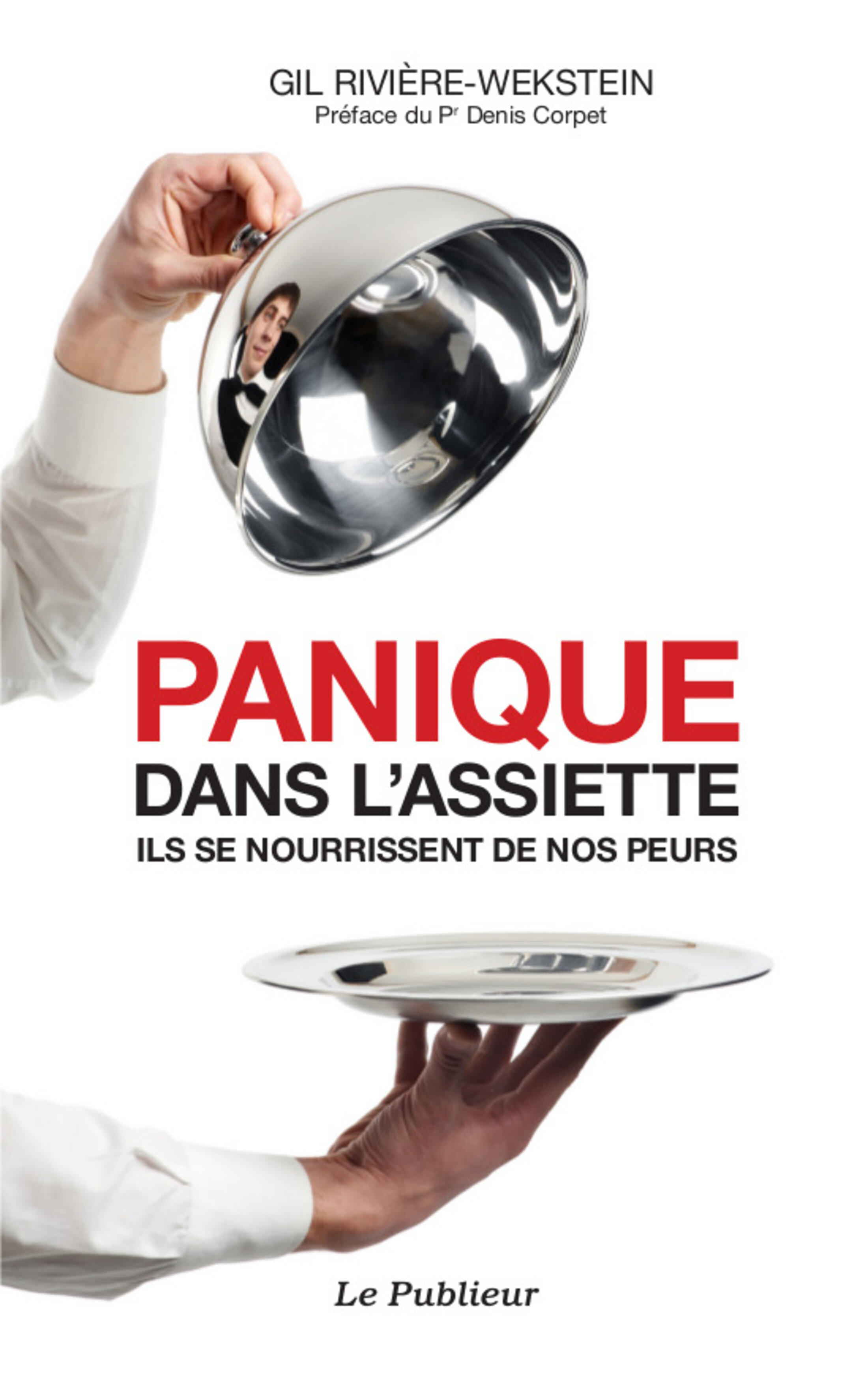
https://www.lepublieur.com/livre/panique-dans-l-assiette-gil-riviere-wekstein-denis-corpet/
Le dernier rapport de l’EFSA (l’agence européenne en charge de la sécurité des aliments) vient de rappeler que 96% des aliments contrôlés ne contiennent pas de traces de pesticides ou en contiennent à des doses très faibles en dessous des limites légales, mais ça n’empêche pas la crise d’hystérie anti-pesticides de se poursuivre de plus belle.
https://www.efsa.europa.eu/fr/press/news/180725
Donc, on en est là, et on vit une époque où des gens dans le camp dit « progressiste », comme le NPA et la France Insoumise, en arrivent à être tellement azimutés qu’ils prônent une agriculture « sans OGMs et sans pesticides », comme si leur programme agricole avait été rédigé sans neurones et sans synapses.
Dans ce contexte de délabrement intellectuel, ce qui a la cote, c’est l’agriculture bio (ou agroécologique, quand ça n’a pas de cahier des charges précis et que cela peut être un peu tout et n'importe quoi), supposée fonctionner sans pesticides (ce qui est archi faux) tout en étant capable de potentiellement nourrir 9 milliards d’habitants (ce qui est tout aussi archi-faux en l’état).
Et du coup, revenons à notre contexte climatique de ce printemps dernier, qui a été très arrosé et donc très favorable au mildiou. Car, alors que les vendanges approchent à grand pas (elles approchent de plus en plus tôt, du fait du réchauffement global), on voit fleurir dans les médias des articles sur les difficultés des vignobles bio face à ces attaques de mildiou, ce qui offre un tour de France des endroits où ça galère. Comprenons nous bien : ça galère pour tous les vignerons, bio ou conventionnel, il n’y a pas de miracle, comme l’évoquait cet article de Vitisphère de juin dernier :
https://www.vitisphere.com/actualite-87738-La-situation-saggrave-dans-tout-le-vignoble.htm

Agrandissement : Illustration 4

Mais, comme le pointait aussi justement l’article, le problème est particulièrement important dans les vignobles bio.
Par exemple, le 4 juillet, France 3 Occitanie titrait : « Hérault : les viticulteurs bio attaqués à 90% par le mildiou » [comme souvent, le pourcentage du titre est tellement peu clair qu’on ne sait pas ce qu’il signifie]
En juillet toujours, même la rubrique « Planète » du Monde, qui est pourtant un nid d’écolos antipesticides, évoquait les doutes de vignerons bio
Extrait :
« Pourtant, témoignent certains viticulteurs, il est difficile, sous la pression des maladies qui attaquent la vigne, de persévérer dans la voie biologique.
Pablo Chevrot, du Domaine Chevrot et fils, à Cheilly-lès-Maranges (Saône-et-Loire), en pleine terre des maranges et des santenay, parle d'une année "compliquée". "Un certain nombre de collègues qui étaient en conversion bio abandonnent ou préfèrent retarder d'un an ", explique l'agriculteur, âgé de 37 ans, qui gère le domaine de 17 hectares avec son frère et son père. "Le coût écologique risque d'être élevé. En intervenant beaucoup, on laboure et on abîme des terres déjà ravinées par la pluie. On doit écimer pour aérer la vigne et traiter plus."
Sans remettre en question son engagement bio, il admet que les produits de synthèse sont plus efficaces contre la maladie. "L'engagement bio nécessite des investissements et des sacrifices, explique Pablo. Il faut du matériel supplémentaire pour intervenir plusieurs fois afin de désherber. Avec du chimique, il suffit de pulvériser une fois."
Hé oui… Notez ça dans un coin de votre tête pour la suite : dans le bio, comme on s’interdit les pesticides chimiques (pour des raisons qui tiennent de la religion plus que du développement durable), du coup on a besoin d’ « intervenir » plus souvent, et ça, ça a un coût écologique…
C’est même plus que suggéré dans le même article un peu plus loin :
« Plus au nord, à Magny-lès-Villers (Côte-d'Or), Claire Naudin, du domaine Henri Naudin-Ferrand, possède des vignes en bio et en conventionnel. Proposant notamment des hautes-côtes-de-beaune et hautes-côtes-de-nuits, la viticultrice est intervenue pour limiter les dégâts. Elle estime que ces mauvaises conditions climatiques lui ont permis de comparer les deux techniques. "J'ai utilisé du soufre et du cuivre en bio, du systémique et du pénétrant pour le conventionnel, et je ne vois pas de différences, fait-elle valoir. Certains aspects dans le biologique peuvent ne pas être très développement durable." Exemple : en ne traitant pas les vignes avec des herbicides, on augmente le nombre de passages du tracteur pour désherber, et donc les émissions de CO2. »
Hé oui….
Retour dans l’Herault cette semaine, où France Bleue nous dit que « Le mildiou ravage les vignobles bio de Saint-Saturnin-de-Lucian ».
Extrait :
« Cela fait 20 ans que Virgile Joly tient son domaine biologique à Saint-Saturnin-de-Lucian (Hérault). Mais la récolte de l'année 2018 ne s'annonce pas au beau fixe. "Sur cette parcelle, on a des grappes qui ont complètement séché. Les feuilles aussi ont noirci. On dirait que tout a brûlé". La moitié de son domaine se trouve dans cet état-là. » [c’est la journaliste qui souligne, pas moi]
Hé oui…
Mais, pour autant, la journaliste n’a pas l’air d’être étouffée par le doute, et elle nous offre cette perle :
« Pour traiter ses parcelles biologiques, Virgile Joly n'utilise aucun produit phytosanitaire, seulement du cuivre »
Heu…c’est quoi le cuivre, sinon un produit phytosanitaire ????
C’est même un produit phytosanitaire très utilisé en agriculture bio, sous la forme de la bouillie bordelaise.
Et c’est autorisé en bio, parce que c’est plus ou moins « naturel ».
Sauf que le cuivre, c’est un phyto qui est plutôt franchement toxique (peut-être pour pour les abeilles, mais ce n est pas établi) et qui s’accumule dans les sols parce qu’il est très « rémanent » -(= il ne se biodégrade pas, vu que c'est un metal lourd), ce qui n’est pas vraiment l’idéal pour les vers de terre non plus.
Mais l’article continue :
« Ce n'est malheureusement pas suffisant : "Même un viticulteur qui a bien traité ses vignes en amont de la maladie et de façon régulière a perdu au moins 30% de sa récolte. L'efficacité du cuivre est donc très limitée" »
Ah, OK…
Je résume donc à la hache tout ce qu’on vient de voir :
En viticulture bio, quand le printemps est pluvieux, on passe plus la machine pour désherber (et on émet donc plus de CO2 tout en emmerdant plus les vers de terre), on utilise plus massivement un produit phytosanitaire plus toxique que la moyenne du genre (et notamment que le glyphosate, hé oui…), et au final ça ne marche pas et les récoltes sont largement foutues.
Bravo, le bio, beau bilan !
Et c'est ce truc-là que l'on nous impose de promouvoir dans les écoles comme modèle de développement durable ?????
Et si en agriculture, plutôt que de se donner une obligation de moyens - naturel ou pas naturel ?, OGM ou pas OGM ?, et autres débats ésotériques imposés par les écolos -, on se donnait plutôt une obligation de résultats, tant du point de vue de l’obligation de nourrir correctement tous les êtres humains que du point de vue de la réduction de la pression sur l’environnement ?
Yann Kindo



